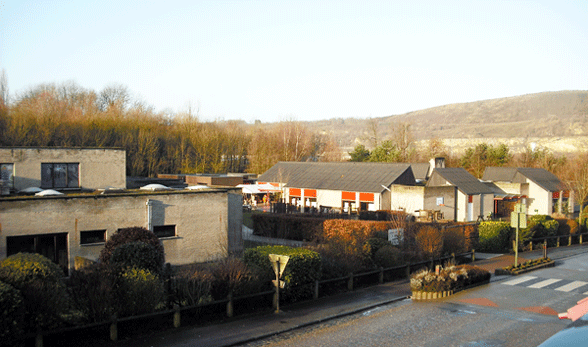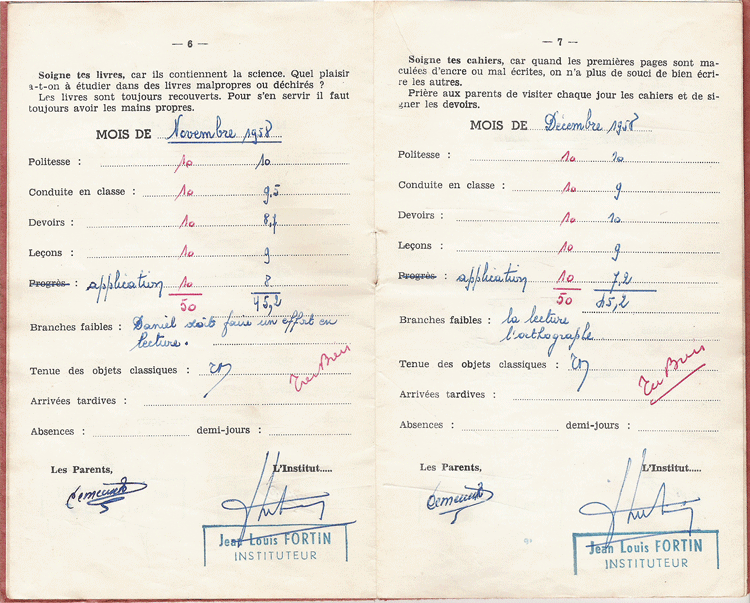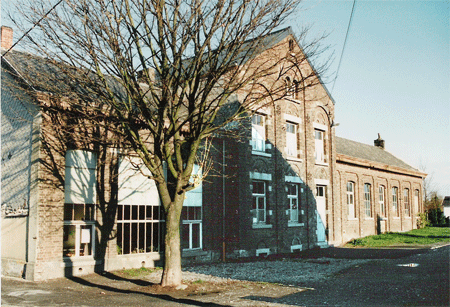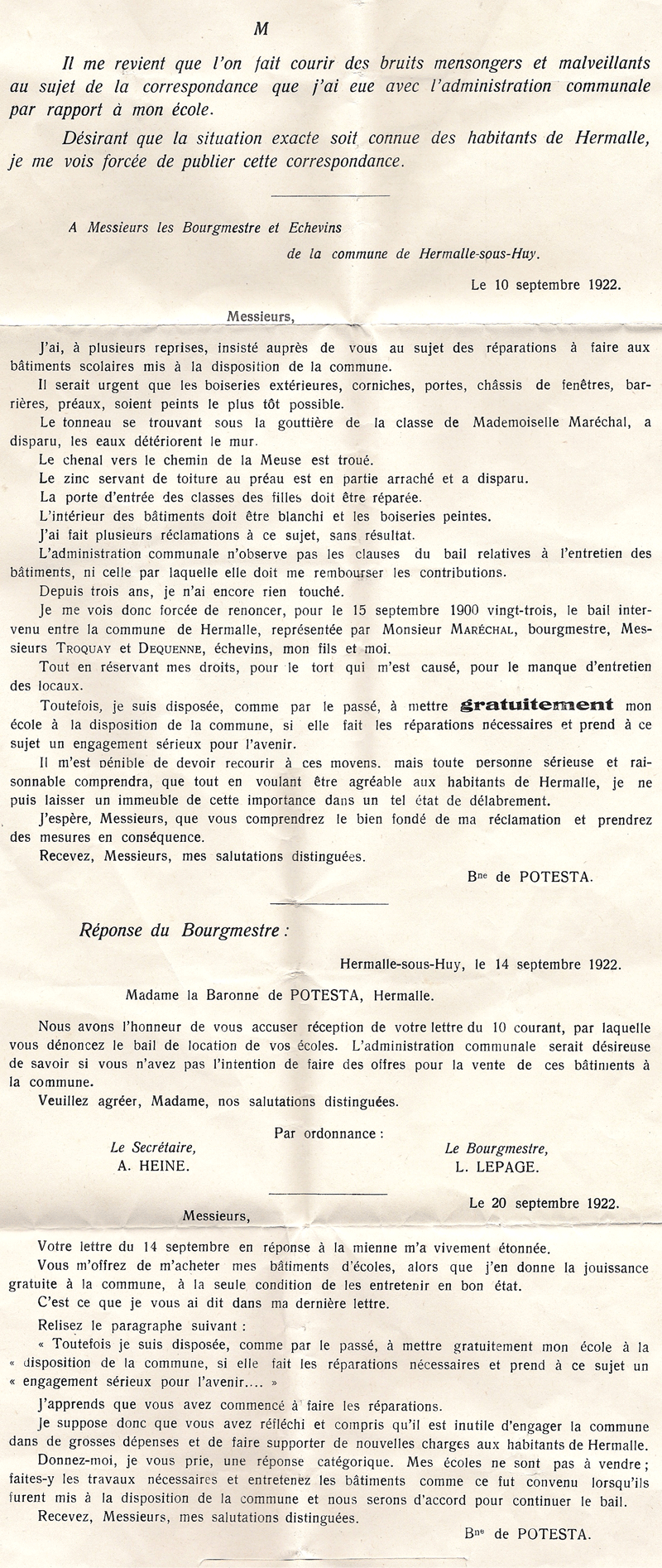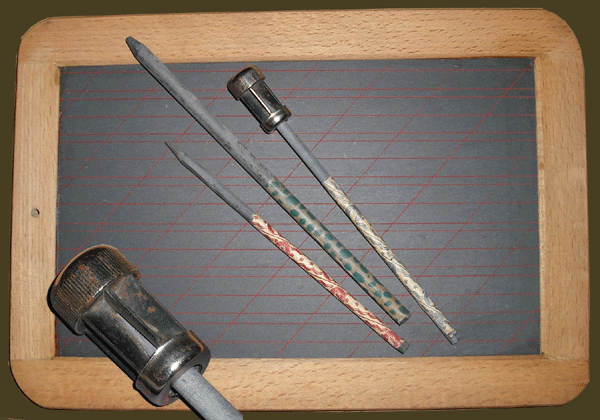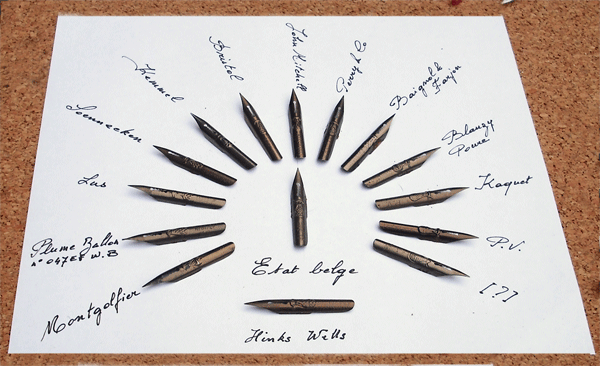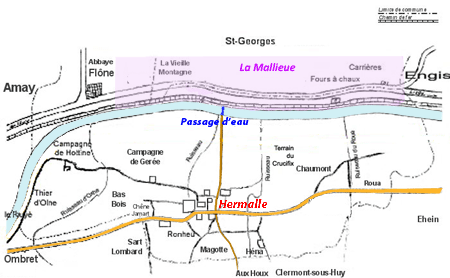Culture
— Les écoles engissoises
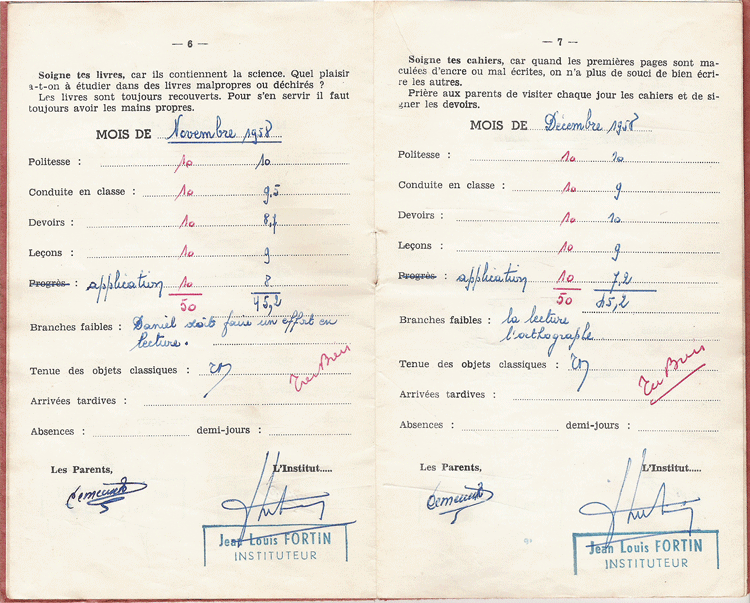 Bulletin scolaire d’un
élève de
l’école hermallienne pour garçons
dirigée
par Roger Brose, novembre et décembre 1958.
Bulletin scolaire d’un
élève de
l’école hermallienne pour garçons
dirigée
par Roger Brose, novembre et décembre 1958.
Éd. A. Dehon, Mons, S. n° 1 — h. 6,5 cm x
l. 10,4 cm.
On remarque que les cotes données concernent la conduite de
l’enfant et non les branches enseignées (la
cotation
compte cinq degrés : Très
bien, Bien, Assez bien, Laisse à désirer
et Laisse beaucoup
à désirer). Dès
la 1ère
page de couverture, le ton est donné :
«
ENFANT !
Ce carnet est-il pour toi un sujet de honte ou de fierté ?
Ta conscience ne te reproche-t-elle rien ? »
La 2e de couverture
comporte les conseils aux enfants avec un texte de Victor Hugo, la 3e
un avis aux parents des élèves, la 4e
un nouvel avertissement aux élèves. La 1ère
page intérieur, elle aussi, s’adresse aux enfants
pour
leur expliquer l’intérêt du bulletin.
Chaque
page suivante commence par un aphorisme et le dernier feuillet
intérieur en ajoute quelques uns :
«
Réfléchis avant de parler.
Ne
dis du mal de personne.
Réprime
ta colère.
Mets
de la décence dans tes expressions.
Soigne
ta petite personne : ne sois pas avare d’eau pour ta figure,
ton
cou, tes mains ; aie soin de ta chevelure ; tiens tes habits
proprement. — L’enfant propre tient aussi
très
convenablement et dans un ordre parfait tous ses objets classiques.
Aime
tes parents ; sois travailleur ; sois tempérant ; sois
économe.
Sois
bon envers les animaux ; évite-leur toute souffrance inutile.
Epargne
pour te procurer des vêtements et pour t’aider dans
la maladie.
Affilie-toi
à la caisse de retraite pour te préparer une
douce et heureuse vieillesse.
Fuis
l’alcool qui appauvrit, qui déshonore, qui rend
fou, qui empoisonne, qui tue l’homme.
Ne
gaspille pas ton argent à l’achat de cigarettes et
de tabac.
Pratique
l’hygiène si tu veux conserver ta
santé, prolonger
ta vie et te ménager une vieillesse sans
infirmités.
Ne
prends pas ce qui appartient au prochain. N’oublie
pas
qu’un menteur est pire qu’un voleur. Choisis de
bons amis ;
dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. »
Le
bulletin donne aussi un extrait de la législation scolaire
et rappelle aux parents :
«
Si vos enfants viennent régulièrement
à
l’école, plus tard, ils ne s’absenteront
pas de leur
travail. S’ils accomplissent proprement et
soigneusement
leur besogne à l’école, plus tard ils
seront de
bons ouvriers, estimés des patrons, bien
rémunérés.
Secondez
donc vos instituteurs et institutrices en assurant la bonne
fréquentation des classes, en obligeant vos enfants
à
faire journellement leurs devoirs avec soin et à
étudier
convenablement leurs petites leçons, en surveillant
consciencieusement la tenue des objets classiques, en inspirant
à vos fils et à vos filles le respect de leurs
maîtres. Evitez de laisser courir trop fréquemment
vos
enfants dans les rues en dehors de votre surveillance, car la rue,
c’est l’école du vice ; c’est
là que se
fait l’apprentissage des mauvaises habitudes, des propos
honteux.
Si
vous voulez faire de vos fils et de vos filles des enfants
éclairés, ne contrecarrez pas
l’école ;
faites-leur aimer ce temple de la science. »
Contexte
historique 
L’enseignement, pendant des siècles, a
été
prodigué par l’Église catholique dans
nos
régions. Lorsque celles-ci sont incluses, en 1815, par la
volonté des grandes puissances européennes, dans
le
nouveau Royaume-uni des Pays-Bas, elles sont régies par une
Loi
fondamentale voulue par le roi Guillaume Ier qui impose à
chaque
commune d’avoir une école primaire
dépendant de
l’État et non plus de
l’Église.
Cette
laïcisation de l’enseignement est l’un des
principaux
griefs des catholiques belges à l’encontre du roi
et
l’une des raisons qui vont provoquer la scission du royaume
et la
naissance de l’État belge en 1830.
L’une des 1ères
mesures du Gouvernement provisoire belge est de rétablir la
liberté d’enseignement — ce qui va
déboucher
sur le système belge, encore en vigueur, de deux
réseaux
d’écoles :
l’« officiel »
organisé par les communes, les provinces, les
Communautés, et le
« libre » dont le
pouvoir organisateur, privé, peut ou non relever
d’une
confession religieuse.
L’école d’alors n’est pas
conçue pour
l’épanouissement personnel de l’enfant ;
lieu
d’apprentissage, c’est surtout l’endroit
où
formater le jeune esprit. Pour les catholiques, c’est un
moyen de
contrôle social tandis que pour les libéraux,
c’est
un instrument d’émancipation, mais dans chaque
camp, et
pendant des décennies, des progressistes vont
s’opposer
aux multiples arguments économiques et moraux
qu’avancent
ceux qui refusent l’instruction obligatoire et les
écoles
gratuites.
L’idée de gratuité des cours pour
permettre
l’instruction des élèves pauvres ne
devient
évidente qu’avec la préparation de la
loi Nothomb
sur les écoles primaires de 1842, mais cette
gratuité
n’incite pas tous les parents à mettre leur enfant
à l’école car ceux-ci, parfois
dès
l’âge de 5 ans, rapportent à la maison
un salaire de
misère mais nécessaire. Bien des gosses
travaillent
jusqu’à 14 heures par jour, et même la
nuit, comme
domestiques ou comme ouvriers dans l’industrie textile, dans
les charbonnages,
les cristalleries…
Une commission d’enquête sur ce travail, en 1843,
note au
chapitre des opinions
favorables, pour une mesure qui fixerait un
MAXIMUM de durée pour le travail des enfants, la
réponse
du patron de la mine de calamine d’Engis : « Les
mesures
protectrices que l’on se propose d’adopter en
faveur des
jeunes ouvriers sont excellentes » ; la commission propose
finalement de limiter le boulot à 6.30 h pour les 10-14 ans
afin
que ces jeunes puissent « fréquenter les
écoles
primaires pendant une moitié de la journée
».
Trop révolutionnaire !
C’est en 1889 seulement que le
travail « dangereux » est interdit aux moins de 12
ans et
« réduit » à 12 heures pour
les plus
âgés ; mais rien n’est prévu
pour ceux
qu’emploient l’agriculture, les petits ateliers, le
commerce.
La Belgique est le dernier pays européen
à rendre, le 19 mai 1914, l’instruction gratuite
et
obligatoire pour les 6-14 ans. Une semaine plus tard, le
travail
est interdit aux enfants de moins de 14 ans.
Mais le 4 aout, l’Allemagne attaque la Belgique et la loi
n’est officiellement appliquée en 1917.
En pratique d’ailleurs, les fraudes et dérogations
sont
tellement nombreuses que de nouvelles lois doivent être
votées, à l’instigation de Jules
Destrée
(Parti ouvrier belge), premier ministre laïque en charge de
l’Enseignement depuis 1884.
Et il faut attendre le système des allocations familiales de
1930 pour voir se généraliser une
scolarité qui
compte parfois 2 années supplémentaires (dites 4e
degré) par rapport aux primaires
d’aujourd’hui.
Avant
la fusion des communes 
Si, dans notre commune, les écoles actuelles appartiennent
toutes au réseau officiel, il n’en a pas toujours
été ainsi…
Réseau
libre 
À
Engis :
De rares mentions dans d’anciens documents indiquent que des
prêtres ont enseigné à Engis au XVIIIe
s. L’enseignement est payant : 10 sols du pays pour
celui
qui ne sait ni lire ni écrire, 15 sols pour
l’élève qui peut le faire.
En 1906, la Compagnie des Filles de la Charité organise
l’enseignement pour quelques dizaines d’enfants
dans son
tout nouveau couvent, rue de la Surface.
En 1919, cet immeuble est transformé par la
Société de la
Nouvelle Montagne (actuelle Prayon) pour l’ouverture
d’un
hôpital et, en 1921, d’une école
maternelle et
primaire qui applique la méthode Decroly
et dispose,
dès 1925, d’une importante
bibliothèque.
Il
s’agit d’un enseignement libre non confessionnel,
mixte, et
les professeurs, essentiellement féminins, sont
payés par
l’État tandis que la Nouvelle montagne assume les
autres
frais en tant que pouvoir organisateur.
Les cours de gymnastique suédoise, obligatoires, y sont
donnés sur la scène parfaitement
équipée
d’une salle de fête de 400 places assises
où se
déroulent des projections cinématographiques
hebdomadaires et des spectacles théâtraux
jusqu’à la guerre.
D’autres cours spéciaux sont peu à peu
ajoutés : la sténodactylo (dès avant
1929, facultative) pour le 4e degré,
la
musique, l’italien (après 1950, facultatif), la
religion
et la morale (à partir de 1963). Les 120
élèves
disposent d’une cantine, les institutrices d’une
salle
à manger et de logements sur place.
L’école est fermée, niveau par niveau,
entre 1971
et 1975 pour des raisons budgétaires ; le
bâtiment
est aujourd’hui un immeuble à appartements.
 Les bâtiments en 2013 : à l'avant-plan
gauche, l'ancien hôpital - à l'extrême-droite,
l'ancienne salle de fêtes-théâtre.
Les bâtiments en 2013 : à l'avant-plan
gauche, l'ancien hôpital - à l'extrême-droite,
l'ancienne salle de fêtes-théâtre.
À
Clermont-sous-Huy :
En 1872, le curé de Clermont fait
construire et ouvre au lieu-dit « Aux Catholiques
», juste
après le cimetière, une école
chrétienne
avec 57 enfants ; à peine 60 jours plus tard et
malgré 21
élèves de plus, elle est fermée pour
six mois sous
prétexte d’humidité — on va
entrer bientôt
dans la Guerre scolaire ! et la loi Van
Humbeek va bannir la religion des cours des
écoles de l’État, — et les
gosses émigrent dans un
local provisoire.
À
Hermalle-sous-Huy :
Au XIXe
siècle (après 1832) et jusqu’en 1912,
ce sont des sœurs qui
donnent cours dans l’ancienne maison vicariale, rue de Meuse
(au n° 1 de
l’actuelle rue du Pont).
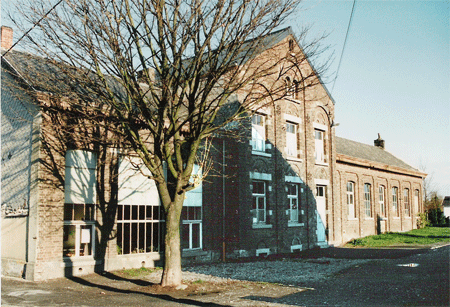 « Anciennes écoles
» de la baronne de Potesta, en décembre 2008.
« Anciennes écoles
» de la baronne de Potesta, en décembre 2008.
L’ancienne école de la rue du Pont, 50 m
plus au nord, à côté de
l’actuel Centre
culturel et de la bibliothèque, a aussi eu des religieuses
pour
professeurs ; on y a distribué la « soupe scolaire
»
pendant la guerre 1914-1918. Ce bâtiment, construit en 1867,
a
été
propriété de la baronne de Potesta qui le mettait
gratuitement, en échange de son entretien, à la
disposition de la commune mais celle-ci ne remplissant pas ses
obligations, il y eut échanges de lettres acerbes et
même
envoi par la baronne, en 1922, d’un courrier à
tous les
habitants d’Hermalle pour les tenir au courant de ses
doléances :
Réseau
officiel 
Le
relevé des écoles ouvertes
spécifiquement par
les pouvoirs publics communaux, et des évènements
particuliers liés aux écoles,
s’établit
comme
suit :
| ±1830 |
Engis |
Une
école communale primaire est
répertoriée dans le
Dictionnaire géographique de Philippe Vander Maelen en 1831.
Elle accueille 75 enfants des deux sexes (pour 679 habitants) dans une
« petite salle, très mal disposée sans
ameublement,
enfin une espèce de cave humide, malsaine ».
Un Recueil de
documents statistiques de 1832 indique qu’il
n’existe pas d’école privée.
Les instruments d’écriture sont le crayon de
graphite ou
celui d’ardoise, appelé
« touche »
et, pour les plus âgés, la plume
métallique.
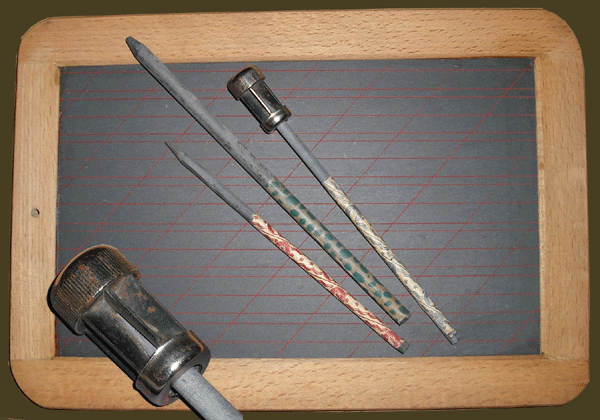
Touches posées sur une
ardoise d’écolier.
À l’avant-plan, un taille-touche.
Coll. Musée Postes restantes |
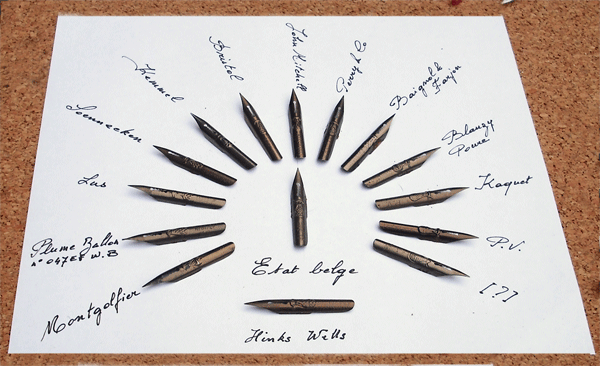
Ensemble de plumes «
Ballon »,
modèle couramment utilisé en Belgique.
Coll. Musée Postes restantes |
|
| 1832 |
Hermalle-sous-Huy |
Hermalle
possède une école communale qui accueille 72
enfants dont
18 filles. Il n’y a pas d’école
privée. |
| 1842 |
Engis |
Un
nouveau bâtiment est érigé au Thier
Oulet,
approximativement au centre des différents hameaux de la
commune
; les séances du conseil communal s’y tiennent et
il
accueille l’école où on apprend la
lecture,
l’écriture et le calcul —
géographie,
histoire et dessin s’ajouteront en 1866).
L’enseignement y est de qualité
puisqu’on note dans
un livre de 1863 que les classes de l’instituteur
Hubert-Joseph
Gonda, qui avait été nommé sous-maitre
le 28
février 1845, ont obtenu la 7e place (sur 112) au
concours
cantonal.
En 1869 l’école compte 122 enfants
d’ouvriers.
Le bâtiment blanc à un étage disparait
au début des années 1980. |
| 1845 |
Hermalle-sous-Huy |
« Par
arrêté royal du 3 janvier 1845, la commune de
Hermalle-sous-Huy, province de Liége, est
autorisée
à contracter, à l'intérêt de
4 p. c., un
emprunt de 1 300 francs, remboursable en dix années
pour
couvrir les frais de construction d'une salle
d'école. » |
| 1849 |
Clermont-sous-Huy |
Une
école communale existe aux Houx, au
rez-de-chaussée de la
maison communale ; cet immeuble va servir de logis pour le maitre
après la construction, 80 m plus loin, d’une
nouvelle
maison communale dont le rez-de-chaussée doit servir
d’école à une classe. |
| 1851 |
Engis |
Les
enfants indigents reçoivent la gratuité des cours
et la
gardent jusqu’en 1884
où tous les enfants qui
fréquentent les écoles communales
d’Engis
bénéficient enfin de l’instruction
gratuite. |
| 1858 |
Hermalle-sous-Huy |
La
Députation permanente au Conseil provincial
décide que
« Les communes de Pepinster, Hermalle-sous-Huy et Ouffet, ont
été autorisées à adopter
des écoles
privées pour l'instruction des filles indigentes.
» Nous
accueillons avec plaisir toute information complémentaire
à ce sujet ! |
| 1862 |
Hermalle-sous-Huy |
Création
de l’École de la Maillieue.
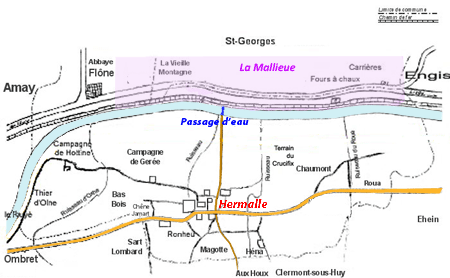
Le 13 juillet 1861, le Conseil provincial de Liège
débat
d’une demande de scission des communes de Saint-Georges et de
Hermalle car la Maillieue désire être
rattachée
à Flône. L’un des enjeux,
c’est
l’école ! Il n’y en a pas sur
la rive gauche
et les enfants de la Maillieue doivent passer la Meuse quatre fois par
jour, par bac, pour se rendre sur la rive droite, à
l’école d’Hermalle…
De cause
à effet, l’instauration d’un passage
d’eau.
La barque
suivait un câble accroché aux poteaux.
Que la
Meuse soit calme ou impétueuse,
Il fallait
la passer, même par vagues dangereuses.
Gustave
Séverin, Souvenirs
(La rue de la Meuse)
Comme ni Saint-Georges ni Hermalle n’ont envie de perdre les
ressources financières que leur apportent les industries de
la
Maillieue, les deux communes s’allient pour proposer la
construction d’une école communale à la
Maillieue
et couper l’herbe sous le pied des
séparatistes.
L’école est effectivement construite
l’an suivant et
les cours s’y donnent jusqu’à la fusion
des communes. |
| 1867 |
Engis |
Les
« adultes » d’au moins 14 ans
reçoivent des cours du 1er
octobre au 31 aout, à raison de 2 heures le soir trois fois
par
semaine en hiver et 2 heure le dimanche en été
pour les
hommes, et 2 heures deux fois par semaine (jeudi et dimanche) pour les
femmes.
Il s’agit de donner quelques connaissances à des
gens qui
n’ont pu les recevoir, enfants, car ils étaient
obligés de travailler ; il s’agit aussi
d’en faire
des gens rangés, vertueux, économes, «
comprenant
les nécessités sociales et ayant le respect de
l'ordre
établi » comme le dit un rapport d’un
Ingénieur en chef, directeur de mines. |
| 1868 |
Engis |

On
construit une école primaire pour filles, chemin de
Warfusée, ce qui arrête la mixité des
sexes.
Cet imposant bâtiment est devenu celui de
l’actuelle
maison communale et le chemin de Warfusée s’apelle
dorénavant rue reine Astrid. Des classes vont y
être maintenues pour les maternelles jusqu’en 1986. |
| 1872 |
Clermont-sous-Huy |
La
nouvelle maison communale accueille une classe… de 11
élèves, les autres enfants fréquentant
l’école ouverte par le curé. |
| 1880 |
Engis |

Une
nouvelle école primaire pour garçons est ouverte
rue de Huy (actuelle rue
Joseph Wauters) étant donné
l’accroissement du
nombre d’élèves mâles ; celle
du Thier Oulet
est fermée. |
| 1884 |
Engis |
Le
journal de classe apparait et permet d’établir une
relation entre parents et enseignants.
|
| 1885 |
Clermont-sous-Huy |
La
loi autorisant les communes à inscrire religion et morale
dans
leur programme depuis l’année
précédente,
tous les jeunes Clermontois sont inscrits dans le réseau
officiel ; 12 adultes suivent aussi des cours en hiver, de novembre
à fin février.
L’école accueille aussi
des petits Éhinois car Éhein ne dispose pas
d’école ; elle paye donc
l’écolage à
Clermont. Filles et garçons ont « leur
école » (il faut comprendre
« chacun leur
classe »). |
| 1894 |
Clermont-sous-Huy |
Les
classes pour adultes se tiennent, de novembre à fin
février, dans le bâtiment de
l’administration
communale. Les cours se donnent au moins jusqu’en 1926. |
| 1904 |
Engis |
Le
photographe entre à l’école ; les
premières
photos de classe et de chaque élève apparaissent.
|
| 1916 |
Engis |
La
visite médicale devient obligatoire.
|
1918-
1940 |
Hermalle-sous-Huy |
L’instruction
semble avoir été aussi dispensée entre
les 2
Guerres mondiales dans trois classes organisées dans la
Maison
de la Héna, bâtiment de la rue Lecrenier qui avait
dépendu jadis de l’Abbaye de Flône, et
où
était installé le secrétariat
communal. |
|
|
L'instituteur Roger Brose qui exerce à La Mallieue est cité comme l'un des pionniers du Mouvement Freinet de l'entre-deux-guerres. |
| 1922 |
Engis |
On
crée une école pour filles aux Kessales.

La maison à étages (à gauche de la
photo)
était le logement réservé à
l'institutrice
en chef (nom donné à la fonction de directrice).
|
| 1963 |
Clermont-sous-Huy |
Début
de la mixité : tous les élèves,
garçons et filles, sont regroupés en 2 locaux, 1ère
et 2e
années dans l’un, 3e
à 6e
année dans l’autre. Une classe maternelle est
installée dans le salon du presbytère
jusqu’à la construction d’une salle
complémentaire à
l’école. |
| 1964 |
Clermont-sous-Huy |
La
classe maternelle entre dans la nouvelle salle. |
| 1964 |
Engis |

La
nouvelle école des Fagnes est opérationnelle ;
elle
évite aux écoliers de devoir faire à
pied le long
trajet Fagnes-Centre d'Engis-Fagnes, soit quelque 6 km.
|
| 1965 |
Clermont-sous-Huy |
On
organise un cours de morale non confessionnelle pour… trois
élèves. Le ramassage scolaire
débute… avec
le taxi Guyot d’Engis !
La population scolaire a augmenté, obligeant à
l’occupation de la salle du conseil communal puis
à la
construction d’une classe préfabriquée
(qui sera
démontée en 1994). |
| 1967 |
Clermont-sous-Huy |
Un
minibus communal remplace le taxi. |
| 1968 |
Engis |
Toutes
les écoles pratiquent la mixité. Les
enfants sont
répartis entre les écoles : celle des
Kessales accueille les 1ère,
2e et 3e
années, celle de la rue Wauters les 4e,
5e et 6e.
|
| 1970 |
Clermont-sous-Huy |
On
construit un réfectoire et on installe de chauffage
central.
Il est fini le temps des poêles !

Prise de vue en octobre 2010. L'immeuble
de droite, à batière, est la maison
communale-école de 1872. |
| ±1975 |
Engis |
La
commune innove en décidant la construction d’une
piscine
de petite profondeur dans l’école Wauters par
réutilisation d’une classe et d’une
partie du local
à usage médical, pour éviter les frais
dus
à la piscine de Stockay. Cette piscine va
être
fréquentée d’abord par les enfants des
classes
primaires puis aussi par ceux des maternelles.
|
Après
la fusion des communes 
| 1977 |
Fusion
des communes |
Les écoles des 3 villages
deviennent celles
de l’entité engissoise.
Pour créer un emploi supplémentaire, les
écoles
de Hermalle et Clermont sont momentanément
fusionnées. |
| 1982 |
|
Les
subsides de la Communauté française de Belgique
permettent la construction de l’école-pilote
fondamentale
d’Hermalle. Elle doit rassembler les
garçons qui ont
cours dans l’administration communale, au coin de la
chaussée Freddy Terwagne et de la rue Wérihet, et
les
filles installées dans les « anciennes
écoles
» de la rue du Pont — lire
ci-après. |
| 1986 |
|
L’ouverture
d’une école pour les 1ères
et 2e maternelles,
l’École du Parc (derrière
l’actuelle maison des
Jeunes, dans le Parc des Tchafornis), permet de libérer les
locaux
encore occupés par les enfants dans
l’administration communale d’Engis.
|
| 1987 |
|
Création
de la réserve naturelle pédagogique à
l’école de Hermalle — lire
ci-après. |
| 1991 |
|
Les
élèves de 6e de
Hermalle prennent chaque jour le bus pour aller suivre les cours avec
les élèves de Clermont car le nombre
d’enfants ne
permet pas l’organisation de 2 classes distinctes ; cette
situation dure au moins jusqu’en 1995. |
| 1993 |
|
La
surpopulation des maternelles oblige à
l’agrandissement de l’école
d’Hermalle. |
| 2006 |
|
Trois
nouvelles classes ajoutées du côté de
la réserve naturelle pédagogique,
à Hermalle. |
| 2016 |
|
En
septembre 2016, l'établissement d'Hermalle accueille un projet
prédagogique et éducatif totalement dédié
aux enfants souffrant du Trouble Déficitaire de
l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H) :
l'école Grandir autrement.
Cette école privée respecte le programme d'enseignement
de la FWB et se soumet à son inspection. Elle peut accueillir 12
enfants, en deux groupes-classes. La base de l’équipe
d'encadrement est composée de trois enseignants : un
psychomotricien, une spécialiste en
psychoéducation du TDA/H et en troubles des apprentissages et
une enseignante bénéficiant d’une expérience
de plus de vingt ans.
Ils sont aidés par une accompagnatrice psychologique et une
assistante éducative. D’autres professionnels encadrent
différentes activités comprises dans l’horaire
comme hippothérapie, yoga, karaté, atelier cirque,
atelier nature, méditation de pleine conscience,
théâtre, cuisine… |
|
Les avantages
et aléas d’une école-pilote
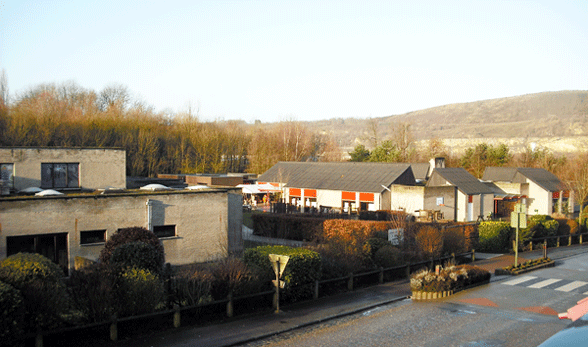 L'école vue du 1er
étage du Centre culturel en 2008. A doite le
bâtiment qui abrite les classes,
L'école vue du 1er
étage du Centre culturel en 2008. A doite le
bâtiment qui abrite les classes,
séparé par la cour de
récréation du
réfectoire et de la salle de sport Grandfils (avant-plan
gauche).
L’actuelle école d’Hermalle est donc
ouverte rue du
Pont en 1982 et connait des débuts difficiles…
La commune, voulant agrandir l’ancienne école de
la
Baronne de Potesta, a acheté dans ce but un terrain qui
appartenait à la Petite propriété
terrienne, mais
son projet d’agrandissement ne rencontre pas
l’assentiment
de la Communauté française qui n’offre,
à
l’époque, de subsides importants que pour la
construction
d’écoles « de l’an 2000
».
Ce type d’« école ouverte
» est
basé sur un concept éducatif né en
Angleterre et
essaimé dans divers pays dont les U.S.A. et la France dans
les
années 1960-1970.
Le concept prend en compte l’influence de la structure
même du bâti sur la pédagogie.
Comme on cherche à « ouvrir »
l’éducation, on pense que la création
de «
classes ouvertes » va constituer le dispositif spatial
adéquat pour une pédagogie non magistrale, qui
doit
permettre à l’enfant de progresser à
son rythme, de
recevoir un enseignement plus individualisé qui utilise
mieux
les compétences et les intérêts des
enseignants,
d’apprendre à vivre en
société.
Ce type d’école expérimentale implique
un
changement de projet pédagogique et d’autres
méthodes de travail pour les enseignants, mais ceux
d’Hermalle ne reçoivent pas de formation
préalable.
En diverses écoles, l’aire ouverte comporte des
espaces
où s’isoler. Ce n’est pas le
cas à
Hermalle (ni à Villers-le-Bouillet qui construit une
école semblable à la même
époque).
À l’intérieur de notre
école, aucun mur
— sauf pour les sanitaires (et une salle de bain avec petite
baignoire existe pour les maternelles, ce qui va
s’avérer
bien pratique car des petits sont parfois amenés
à
l’école dans un mauvais état
d’hygiène…)
Rien n’isole donc les classes dont l’aire
n’est
délimitée que par le placement de meubles de
rangement de
± 120 cm de haut.
Un tapis plain recouvre partout le sol, tant dans les sections
destinés aux classes que dans
« l’agora », long et
large espace central
de circulation. Bien entendu, le tapis est vite et
inévitablement taché. Pire, un vandalisme
provoque une
inondation et le tapis pourrissant va être
remplacé par un
carrelage, plus pratique mais… bien plus sonore.
Les enseignants disent y avoir vécu un calvaire : le bruit
est
épouvantable puisqu’aucune cloison
n’arrête
les sons, qu’ils proviennent des paroles des instituteurs et
des
élèves, des déplacements des chaises,
du
claquement des cartables, etc. ; les leçons de chant ne sont
plus possibles au risque de voir les élèves
d’autres classes abandonner leur travail pour chanter en
cœur… La vue passe au-delà des meubles,
l’intimité de la classe n’est pas
assurée ;
le professeur qui élève la voix face à
un
élève problématique perturbe
immanquablement
le travail de ses collègues et distrait les autres enfants.
Pendant les récréations, les enfants jouent dans
la
pelouse qui entoure les bâtiments et leur surveillance se
révèle impossible étant
donné
qu’aucune clôture ne délimite
l’espace de jeu
et que les gosses peuvent contourner sans difficulté tant
l’immeuble qui abrite les classes que celui,
séparé
d’une trentaine de mètres, qui abrite le
réfectoire
et l’immense salle de sport avec ses sanitaires.
Aucun préau, d’autre part, n’a
été
prévu pour les temps de pluie, et l’agora ne
convient
pas puisque les heures de récréation des
maternelles
et des primaires ne sont pas les mêmes, et que les cris, les
courses et les jeux des uns dérangeraient les
autres…
Des aménagements vont donc être peu à
peu
introduits : construction de murs intérieurs, partiellement
vitrés, refermant l’aire ouverte en classes
traditionnelles en 1992, construction de deux préaux en
1995-1996.
L’ouverture de l’école correspond
à un
changement de directeur : à Monsieur Fortin
succède
François Grevesse qui aide beaucoup les institutrices
à
la mise en place d’un cycle « 5-8 ans »
imposé
par la Communauté française — mais sans
formation
préalable, avec seulement, au début,
l’aide ponctuelle de deux
personnes détachées par l’Union des
villes et
Communes.
Les maitresses travaillent sur un projet pédagogique commun,
formant des groupes « verticaux »
d’enfants de tous
les âges, entre lesquels sont réparties diverses
tâches et activités, ce qui représente
une
nouveauté pédagogique.
Les élèves bénéficient de
la
création d’ateliers (travail manuel/bricolage,
jeux de
société/éducatifs,
théatre/expression
orale, nature) qui se donnaient deux fois par semaine en
début
de semaine.
Ce type de travail, qui implique beaucoup de préparations et
de réunions
intra et extra-scolaires, va durer une dizaine
d’années puis on va revenir peu à
peu à un enseignement plus traditionnel, sans doute
à cause d’un manque
de personnes-ressources pour aider les institutrices.
L’école dispose aussi alors d’une BCD,
une
Bibliothèque-Centre de documentation ; des ordinateurs y
sont
installés avec l’aide du Centre culturel et des
ateliers
de lecture, utilisant le logiciel Elmo
international
auquel un membre du personnel a été
formé, vont
aider les élèves les plus faibles à
acquérir une vitesse de lecture supérieure,
indissociable
d’une meilleure compréhension. Des
Apple (iMac Bondy Blue
G3) vont succéder à la
première génération de machines.
L’école a été
vandalisée à
plusieurs reprises. Elle perd ainsi la petite serre où les
enfants cultivaient des plantes et où se trouvaient quelques
animaux. Mais les bâtiments n’occupent
qu’une portion
du terrain communal de 1,5 ha dont une partie constitue un champ de
pommes de terre, juste derrière l’école
et le long
du chemin de Gerée…
Le directeur, François Grevesse, a
l’idée d’y
inscrire un « grand livre vivant de sciences
naturelles ».
Approuvé par le pouvoir communal, il crée en
décembre 1987, avec l’aide des membres de la
Commission
des chemins communaux (dont Jean-Marie Willems et Valève
Bovy)
et d’autres amis, une sorte de réserve
pédagogique
naturelle à la place du champ. Pendant six mois, tous
suivent
une formation hebdomadaire (le samedi) avec un guide de la Province
pour apprendre comment dévier le ruisseau du
château,
planter des arbres, aménager des nichoirs…
En février 1988, 50 arbres, souvent
prélevés dans
les environs, ont été replantés ; en
mars, de
jeunes Hermalliens placent des nichoirs et en avril, le service Travaux
de la commune commence à creuser, au bulldozer, la
« mare
» que le ruisseau va alimenter.
L’aménagement et l’entretien vont se
poursuivre des
années durant, avec l’aide de l’asbl
Éducation Environnement, constituant un nouvel axe de
formation
pour les élèves.
La « réserve naturelle » de
l’école,
d’abord d’accès libre au public, a
ensuite
être clôturée. Elle a
également servi
de but de visite à d’autres écoles de
l’entité et même de communes voisines.
|
Avec nos remerciements à Madame Nicole Delvaux,
à Messieurs Jean Flagothier, Marcel Fréson,
François Grevesse, Armand Pirotte, Jean-Marie Willems.
Nous recueillerons bien volontiers d’autres
témoignages pour enrichir cette page.
|
|